The Conversation : « Les sites « naturels » classés : dépasser l'idée d'une nature musée ? »
Publié par Université Savoie Mont Blanc, le 16 juillet 2024 420
Cet article a été écrit par Lionel Laslaz, enseignant-chercheur au laboratoire Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne (EDYTEM) de l'UFR Sciences et Montagne à l'USMB, ainsi que par Johan Milian, du laboratoire LADYSS à l'Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis. Il est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. [Lire l'article original]
Peu connu du grand public, le « site classé » est l’outil juridique le plus ancien permettant, depuis 1906, la protection d’un site naturel considéré comme « patrimonial ». D’après les derniers inventaires, La France (métropole et outre-mer) compte pas moins de 2700 sites classés (sur un peu plus d’un million d’hectares, soit 1,8 % du territoire terrestre) et 4798 sites inscrits (qui plafonnent eux à 1,5 million d’hectares pour 2,2 % du territoire) pour leur patrimoine paysager.
Ces chiffres peuvent impressionner et laisser imaginer une ambitieuse politique de protection menée à travers ce dispositif. La réalité est plus nuancée. Près de 120 ans après son instauration, nous proposons donc de rappeler les principaux éléments qui ont marqué la trajectoire de ce dispositif afin d’analyser quelle vision de la nature en découle et de mieux apprécier son rôle dans la protection de l’environnement.
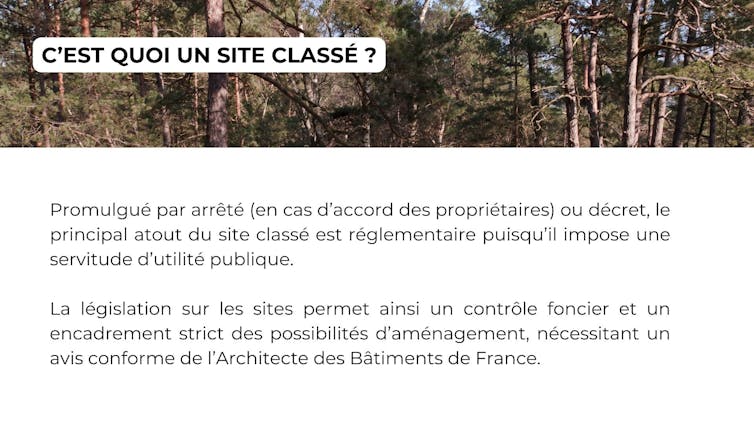
À l’origine de la loi, une vision romantique de la nature
La loi du 21 avril 1906 a d’abord des ambitions esthétiques et vise à « organiser la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique ». Son rédacteur, le député Charles Beauquier, est un historien également fondateur de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, créée en 1901.
Par son attention portée aux « curiosités naturelles », la loi Beauquier est inspirée par le Romantisme et la notion de « sublime » du philosophe irlandais Edmund Burke. Elle prolonge et amplifie le mouvement initié par le ministère des Beaux-Arts avec la création des « séries artistiques » forestières de la Grande Chartreuse (1857) puis de Fontainebleau (1861) : négociées entre les gestionnaires forestiers domaniaux et des cercles d’influence promoteurs d’une protection des paysages à forte valeur picturale, ces initiatives restaient toutefois à visée patrimoniale, ponctuelles et s’effectuaient sans cadre législatif.
La loi Beauquier, et sa continuité, la loi de 1930 ayant pour objet de réorganiser « la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque », apportèrent ce point d’appui législatif manquant. Pendant plusieurs décennies, cela fit du site classé le seul outil permettant de maîtriser le foncier et d’en limiter l’aménagement.
Le « paysage pittoresque » – qualificatif dont le sens premier signifie « qui mérite d’être peint » – constitue le critère qui domine durant plus d’un demi-siècle, mais il n’est pas le seul. En pratique, le dispositif est utilisé par différents acteurs poursuivant des finalités diverses : l’attractivité et la promotion touristique (le lien avec le développement du tourisme automobile, porté par le Touring Club de France notamment, est connu), la protection d’un système économique (vallées du gave de Cauterets, 1928) mais aussi le naturalisme scientifique : ainsi les premières réserves « naturelles » créées par acquisition ou contractualisation se sont appuyées sur la législation relative aux sites classés, tels les Sept-Iles en Bretagne (1912), la Camargue (1927) ou encore le massif du Néouvielle dans les Pyrénées (1935) en faisant aboutir tôt ou tard des demandes de classement.

Fourni par l'auteur
L’appétit pour les sites classés au cours du XXᵉ siècle
La loi sur les sites agit comme un dispositif de mise en mémoire collective de référents paysagers à la fois singuliers par leurs spécificités et représentatifs des valeurs et des goûts culturels des classes dominantes, urbaines et lettrées. Le Régime de Vichy s’est notamment activé autour de ce dispositif, en promouvant une approche muséale et conservatrice du paysage. Le catalogue des grands sites du territoire contribue alors à asseoir le volet terrien et agrarien de son idéologie conservatrice. Les « paysages immanents » s’incarnent dans des exemples retraçant une forme de « monumentalité » comme la Meije, montagne emblématique des Hautes-Alpes (sites inscrits en 1943 et 1944 pour près de 3000 ha, qui seront intégrés en zone centrale du parc national des Écrins, mais n’empêcheront pas la construction du Téléphérique des Glaciers de la Meije (1976) et de deux téléskis sur le glacier de la Girose).
Peu mobilisée dans le contexte de l’après-guerre, la législation sur les sites classés fait l’objet d’un regain d’intérêt à partir de 1957 où elle sert de véhicule juridique pour l’introduction de la première mention des réserves naturelles. À l’époque de l’installation du premier Ministère de l’Environnement (1971), la perspective change et une approche par « grands ensembles paysagers naturels représentatifs » permet de classer de vastes périmètres comme la Forêt de Fontainebleau (1964) ou le massif du Mont-Blanc, plus grand site classé de métropole (1951 puis 1952 et 1976, 26 123 ha au total).
Dans les décennies 1970 à 1990, au plus fort de la déprise rurale, l’outil est amplement utilisé notamment en montagne, pour contrebalancer la poussée des aménagements d’infrastructures industrielles et touristiques, là où les parcs nationaux n’étaient pas déployés (Vanoise, Écrins, Mercantour, Pyrénées). Des opérations de reclassement et d’extension de sites sont menées dans cet esprit (Verdon, vallée d’Ossau, massif du Canigou). La démarche a été moins mobilisée sur les bords de mer et leurs arrière-pays, malgré quelques secteurs emblématiques (Cap Gris Nez, Dune du Pilat, Calanques), du fait de l’intervention du Conservatoire du Littoral.
L’une des évolutions majeures de l’outil a consisté en la mise en place à partir de 1976 du dispositif des Opérations Grands Sites, destinées à maîtriser la fréquentation touristique et limiter leur artificialisation. Le site classé concerné devient progressivement un outil d’animation qui permet de disposer de moyens financiers de l’État. Cette trajectoire ne concerne cependant qu’un nombre très réduit de sites (53 sur 2700 : les 21 Grands Sites de France et les 32 Opérations Grands Sites destinées à terme à obtenir ce label).
Hors du réseau, la très grande masse des sites naturels classés « ordinaires » ne fait pas l’objet de la même attention des pouvoirs publics et des politiques, et demeure largement méconnue du grand public. En outre, la démarche d’obtention du label peut s’avérer particulièrement longue (Cirque du Fer à Cheval, Falaises d’Etretat, Dunes de Flandre, Presqu’île de Giens et Salins d’Hyères), décourageant certains projets qui finissent par être abandonnés (Vallée de la Clarée, Hautes-Alpes).

Fourni par l'auteur
Des sites disparates et sans politique nationale : quelle utilité et quel devenir pour les sites classés ?
De nombreux sites ont été classés au titre de leurs composantes paysagères de « caractère naturel », incarnés par des paysages ruraux cultivés ou pastoraux, forestiers, des milieux aqueux (lacs, étangs, rivières) ou encore des formations géologiques de surface ou souterraines.
L’utilisation volontariste du dispositif a pu jouer efficacement dans la protection de certains secteurs de naturalité forte, même si des compromis d’aménagement furent concédés dans certains cas, à l’image des téléphériques de l’Aiguille du Midi et de la Vallée Blanche pour le site du Mont-Blanc.
Pourtant, les organisations de référence en matière de biodiversité, tels que l’Union mondiale pour la Nature (UICN) à l’échelle internationale ou l’Inventaire national du Patrimoine Naturel (INPN), n’intègrent pas les sites classés dans leurs bases de données. Le site classé reste un outil conçu et imaginé selon une approche muséale, ce qui en a fait sa force mais aussi sa faiblesse. Il est ainsi en contradiction avec les visions intégratrices et dynamiques qui se développement dans les milieux de la conservation à partir des années 1980.
Les curiosités et points de vue des sites classés ont été définis suivant une logique ponctuelle et géométrique, restreignant souvent leur emprise foncière à quelques ha. Par exemple, la route du plus haut col routier de France (l’Iseran, 2764 m.) est jalonnée de trois sites classés de 10,91 ha chacun (200 m de rayon autour d’un belvédère). Créés deux ans après l’inauguration de la route (1937) par le Président de la République Albert Lebrun, ils revêtent une visée principalement panoramique, comme les affectionnait le Touring Club de France, principal promoteur de l’ouverture de cet axe. Une autre difficulté a touché un nombre significatif de sites, celui d’une forme d’anonymisation progressive : ils ont ainsi fréquemment préfacé d’autres outils de protection, sans pour autant y être totalement fondus.
Héritier d’une approche hybride, l’outil site classé pâtit également d’une position ambiguë au sein des appareils administratifs, tiraillé entre Ministère de la Culture et Ministère de la Transition écologique. Dépourvu de personnel dédié et de support méthodologique, malgré quelques tentatives, il ne permet pas de faire de suivi de la biodiversité ni véritablement de gestion. Le classement n’implique pas non plus un programme de restauration écologique ou paysagère. Cette situation ne plaide assurément pas en leur faveur au vu des référentiels actuels dans la technostructure de l’ingénierie de la conservation.
Aujourd’hui, la mise en œuvre et le suivi du dispositif site classé ont été délégués à l’échelon régional du Ministère de la Transition écologique, les DREAL. Une circulaire de 2011 dressait une liste ambitieuse de nouvelles créations de sites, peu avancée à ce stade. La Stratégie nationale biodiversité 2030 publiée en 2022 leur accorde peu de place. Quant à la Stratégie nationale des aires protégées 2030 adoptée en 2021, elle n’en fait guère plus état (une unique occurrence en 82 pages ; les sites inscrits ne sont pour leur part jamais mentionnés). Cette faible considération peut donc surprendre puisque ce même document déplorait qu’« en 2021, seulement 1,8 % de ces espaces étaient sous protection forte » alors même que le décret définissant la protection forte en 2022 reconnaît « au cas par cas » les sites classés comme pouvant en relever.

Fourni par l'auteur
Nombre de sites font aujourd’hui face à des évolutions et des enjeux pour lesquels des arbitrages doivent être faits (pression de l’urbanisation, changements d’usages ou des faciès paysagers en lien avec l’évolution climatique). Cette situation questionne la gouvernance dont ils sont l’objet : les commissions départementale et supérieure (au niveau national) des sites, perspectives et paysages sont-elles toujours les instances les plus idoines pour les superviser ? Ont-elles les outils nécessaires à leur disposition ? L’ouverture de la plate-forme SITE (Sites et territoires d’exception) actuellement développée par le Ministère de la Transition Écologique fournit pour la première fois une interface de communication et de ressources spécifiquement dédiées à ces protections, incluant les sites classés. C’est peut-être là l’opportunité d’une nouvelle impulsion pour ce dispositif.




